Christianisme , laïcité, accueil : une cohabitation naturelle, pas une contradiction
L’idée selon laquelle les racines chrétiennes de la France seraient incompatibles avec la laïcité ou l’ouverture à l’autre est une construction idéologique récente, souvent instrumentalisée à des fins politiques ou communautaires.
En réalité, la foi chrétienne, telle qu’elle a infusé dans notre histoire et nos traditions, offre un socle éthique puissant : hospitalité, pardon, justice, humilité. Ces principes, loin d’être antagonistes avec la République, en sont les piliers invisibles.
À l’heure où le pays se déchire entre identitarismes agressifs et multiculturalisme sans colonne vertébrale, il est temps de remettre à plat cette fausse opposition.
I. La République n’a pas aboli le christianisme, elle l’a encadré.
Fait historique vérifié :
La laïcité, telle que définie par la loi de 1905, n’interdit pas la religion : elle garantit sa liberté tout en séparant les pouvoirs religieux et politiques. En clair :
L’État ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte… mais il protège le libre exercice de tous.
Cela implique deux choses fondamentales :
- Le christianisme a toute sa place dans la sphère privée et culturelle, y compris dans les traditions populaires (Noël, Pâques, mariages, processions locales).
- L’État ne peut pas exclure ces traditions sous prétexte de neutralité, tant qu’elles ne s’imposent à personne.
Conclusion :
Le problème ne vient pas de la laïcité, mais d’une dérive interprétative qui confond neutralité et amnésie collective.
II. Le christianisme français : matrice de l’accueil, pas du rejet
Historiquement, c’est l’Église (souvent rurale, paroissiale, locale) qui a :
- fondé les hôpitaux, les écoles, les orphelinats,
- accueilli les vagues d’immigrés italiens, espagnols, polonais, vietnamiens,
- nourri les mouvements de solidarité ouvrière, paysanne ou étudiante.
Le message évangélique est sans équivoque : « J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli. » (Matthieu 25:35)
Constat actuel :
Les chrétiens pratiquants sont encore aujourd’hui parmi les premiers engagés dans l’aide aux migrants, aux SDF, aux femmes seules ou aux personnes handicapées.
Conclusion :
Réduire le christianisme à une religion identitaire et excluante est une trahison intellectuelle et morale. Ce sont les excès de l’idéologie, pas de la foi, qui engendrent le rejet.
III. Traditions chrétiennes et identité nationale : socle ou camisole ?
Données culturelles et anthropologiques :
La France est pétrie de traditions chrétiennes :
- la structure de nos villages (place, église, cimetière),
- notre calendrier (Noël, Toussaint, Pâques),
- notre langage quotidien (bénir, merci, âme, charité, péché…),
- nos institutions (asiles, soins, justice réparatrice…).
Mais attention : la tradition n’est pas l’obligation, elle est mémoire partagée. Elle donne un cadre, pas une prison.
Vouloir détruire les traditions, c’est comme couper les racines d’un arbre pour qu’il pousse plus vite.
Conclusion :
Les traditions chrétiennes sont un héritage structurant. Elles n’interdisent rien, mais rappellent à chacun ce qui nous lie : le souci du faible, le sens du pardon, la place du sacré dans la vie humaine.
IV. Laïcité militante et effacement culturel : une dérive dangereuse
Depuis 20 ans, plusieurs décisions ont été prises pour évacuer toute trace de culture chrétienne du domaine public, sous couvert de laïcité :
- Interdiction des crèches dans certaines mairies,
- Suppression des croix sur les lieux publics,
- Pressions sur les noms d’école ou d’associations…
Effets pervers constatés :
- Cela crée un ressentiment identitaire, notamment chez les classes populaires attachées à leur culture.
- Cela affaiblit le lien de confiance avec les nouveaux arrivants, qui perçoivent une société sans repères ni racines.
Conclusion :
La vraie laïcité n’est pas une table rase : c’est un espace commun ouvert et structuré. Elle protège les croyants et les non-croyants, à condition que chacun accepte l’histoire du lieu qu’il habite.
V. Vers un pacte français apaisé : foi, raison et fraternité
- Réaffirmer clairement que les racines chrétiennes de la France sont une réalité historique et culturelle non exclusive, mais inclusive.
- Restaurer une laïcité d’équilibre, qui protège les libertés sans détruire les traditions.
- Réconcilier l’identité et l’accueil, en replaçant l’humain, la dignité et la fraternité au cœur du projet national.
Ce n’est pas la foi qui divise, c’est la peur. Ce n’est pas la tradition qui enferme, c’est l’oubli.
VI. Le cœur du message chrétien : ne pas vivre uniquement pour soi
Aime ton prochain comme toi-même. » (Matthieu 22:39)
Cette phrase, répétée jusqu’à l’usure, est souvent citée sans en comprendre la portée : dans la foi catholique, la vie n’a de sens que si elle est tournée vers autrui. Cela ne signifie pas s’effacer ou se nier, mais refuser de devenir le centre exclusif de ses propres préoccupations.
Le Christ n’a jamais promis richesse ou confort à ceux qui croient. Il a appelé au don de soi, à la charité active, à l’attention envers les pauvres, les malades, les exilés, les prisonniers.
C’est une spiritualité du service, pas du mérite personnel ou de la réussite individuelle.
« Celui qui veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur. » (Matthieu 20:26)
Dans la tradition catholique française :
- Les congrégations religieuses ont bâti des hôpitaux, des écoles, des refuges, sans attendre de retour.
- Des milliers de laïcs anonymes vivent leur foi dans l’accompagnement des personnes âgées, des handicapés, des sans-abris, des détenus, sans jamais en faire un sujet de gloire.
Ce que cela implique pour aujourd’hui :
Face à une société marquée par la compétition, le narcissisme et la consommation, le message chrétien nous rappelle l’essentiel :
Une vie utile est une vie donnée.
Et cette morale du don, du sacrifice parfois, n’est pas un carcan religieux, mais une contre-culture féconde. Elle invite à remettre le collectif, la solidarité, la fraternité réelle au cœur de notre civilisation.
Redonner leur place à nos racines chrétiennes, ce n’est pas revenir en arrière. C’est rappeler à chacun que le bonheur ne se trouve pas dans l’ego mais dans le lien, que la grandeur d’un peuple ne se mesure pas à sa richesse mais à sa capacité à protéger les plus faibles.
La France peut – et doit – être fidèle à ses racines chrétiennes sans devenir un pays religieux, et accueillir dignement sans se renier. La solution n’est pas dans la censure culturelle ou dans l’intégrisme, mais dans une redécouverte assumée de ce que nous sommes : un peuple de lumière, de justice et de fraternité.
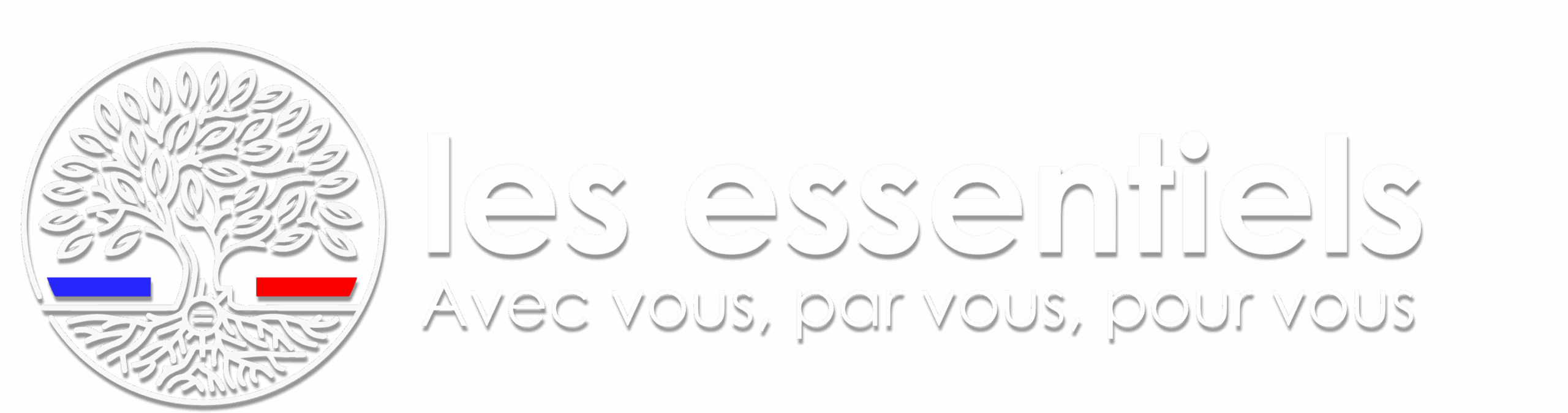
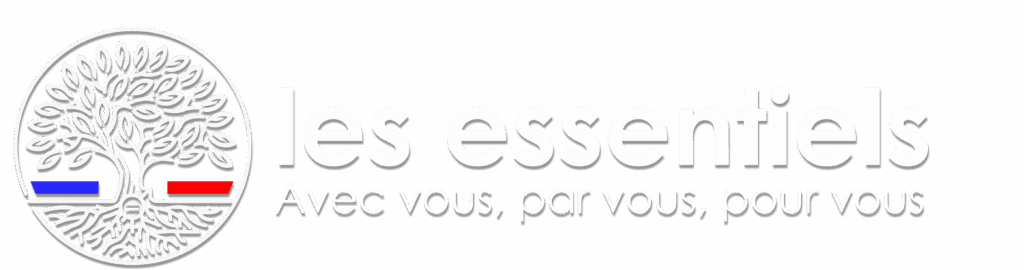


1 Avis sur le sujet
Je suis athée anti-théiste mais assurément plus respectueux de l’autre que bon nombre de théistes, qu’ils soient chrétiens, juifs ou musulmans.
La religion, quelle qu’elle soit n’est fondée que sur l’hypocrisie et la lâcheté devant l’angoisse existentielle face à la mort. Par ailleurs, ses « fous de dieu » qui se présentent comme fondamentalistes ne sont que des extrémistes terroristes, qu’ils soient catholiques intégristes, juifs orthodoxes ou islamistes ;leur autre point commun est d’être liés à l’Extrême Droite.
J’ai subi une éducation catholique, jusqu’à la communion solennelle, dans le petit village breton dont je suis originaire et loin de me structurer elle a généré, à l’adolescence une angoisse qui explosait au moment du pré-sommeil, angoisse que j’ai réussi à maitriser par l’étude de la Mathématique qui m’a permis d’appréhender sans crainte la notion d’infini.
Je m’indigne des contre-vérités ci-dessous (entre guillemets) et développe mon argumentaire en italiques
« Les traditions chrétiennes sont un héritage structurant »
Les deux propositions « J’ai une tradition chrétienne » et « J’ai un héritage structurant » ne sont pas équivalentes, la tradition chrétienne ni une condition nécessaire (cela signifierait qu’un non chrétien n’est pas structuré) ni une condition suffisante (contre-exemples : Abbé Pierre, Bétharram, Scouts d’Europe …)
« Vouloir détruire les traditions, c’est comme couper les racines d’un arbre pour qu’il pousse plus vite »
La métaphore relève du non-sens, quand on plante un arbre il faut savoir éliminer les racines défectueuses. La religion n’est qu’une maison dont les fondations sont pourries.
« Redonner leur place à nos racines chrétiennes, ce n’est pas revenir en arrière.
Il faudrait donc oublier : les Missionnaires colonisateurs,l’ Inquisition, l’Évêque autrichien Alois Hudal et le Prêtre croate Krunoslav Draganovic, nazis patentés…
« Le cœur du message chrétien : ne pas vivre uniquement pour soi »
À lire, pour exemple, les Versets catholiques di-dessous, il faut mieux vivre contre soi.
Luc (6 :28) : « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. ».
Luc (6 :29) : « Quelqu’un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l’autre. Si quelqu’un prend ton manteau, ne l’empêche pas de prendre encore ta tunique. ».
Luc (6 :30) : « Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s’en empare ».
En conclusion, je suis très sceptique quant à l’honnêteté intellectuelle de ce « blog » dont l’ingénierie remarquable nécessite, à l’évidence de gros moyens financiers, je ne serais pas surpris que leurs initiateurs soient « aidés » et manipulés par des milliardaires ou multimilliardaires comme Vincent BOLLORÉ ou Pierre-Édouard STÉRIN, catholiques fanatiques se voulant « directeurs de conscience » qui par leur volonté de mainmise sur les médias ou le label « Les plus belles fêtes de France »œuvrent ouvertement pour l’Extrême-Droite et particulièrement le RN-FN qui a converti son acharnement anti-juif en anti-musulman. En revanche je me retrouve tout à fait dans « INDIGNONS NOUS ».